|
|
|
3ème partie - Chapitre 1 : L'appareil de production de la parole
|
Ce chapitre est consacré à l'appareil que l'être humain utilise pour
produire des sons durant la phonation. En guise d'introduction, nous allons faire un parallèle entre la
production de la parole et la pratique de certains instruments de musique.
|
|
Lorsqu'un musicien joue de l'orgue, il utilise un instrument que l'on peut schématiser
selon la figure suivante.
Une soufflerie envoie un flux d'air sur un biseau, placé au bas du tube au niveau d'un rétrecissement. Sous l'action du flux d'air, un biseau est mis en vibration et génère ainsi une onde périodique qui se propage alors dans un tube, générant une note. Un biseau est une pièce très fine qui peut se déformer sout l'action d'un souffle d'air, tout comme une feuille de papier peut vibrer si l'on souffle sur sa tranche. Le son produit dépend : D'un point de vue fonctionnel, l'instrument peut se décomposer en plusieurs sous-systèmes qui ont chacun leur rôle:
|
|
L'exemple précédent était très simple. En effet, le tube étant de dimension fixe, la note produite est toujours la même si la soufflerie ne varie pas. Etudions maintenant l'exemple d'un musicien jouant de la flûte à bec :
le joueur souffle dans le bec de l'instrument ; le flux d'air met en vibration un biseau et l'onde périodique créée se propage dans le corps de l'instrument. En agissant sur la forme du tube (en bouchant les trous), on modifie le son produit. Ce son dépend : D'un point de vue fonctionnel, l'ensemble musicien + instrument peut se décomposer en plusieurs sous-systèmes :
On peut également noter que le musicien a également un autre rôle, puisque c'est son cerveau qui commande la soufflerie (son expiration), ainsi que la position des doigts sur la flûte, donc les notes produites. Ces deux exemples permettent de comprendre comment fonctionnent certains instruments de musique : un son est produit par mise en vibration d'un objet, le vibrateur, qui génère une onde périodique à partir de l'énergie apportée par une soufflerie. Cette onde se propage alors à travers un résonateur qui modifie sa forme et produit ainsi une note. D'autres instruments fonctionnent selon d'autres modes de production (par exemple, avec une guitare, on retrouve le vibrateur - la corde - et le résonateur -le corps de la guitare -, mais l'énergie est apportée par le mouvement du doigt du guitariste et non par une soufflerie), mais nous allons voir que la phonation a de nombreux points communs avec les exemples présentés ici. |
|
L'appareil de production de la parole fonctionne selon un schéma proche de l'ensemble musicien + flûte. Le cerveau humain commande à la fois la soufflerie et le choix des "notes" ou sons du langage produits. Les parties du cerveau entrant en jeu lors de la production de parole sont appelées système de production central, par opposition avec les organes ci-dessous, regroupés dans le système de production périphérique.
Les deux paragraphes suivants vont décrire plus en détail les différents systèmes périphériques de production. L'étude du système de production central, relevant de la linguistique et des sciences cognitives bien plus que de la phonétique, ne sera pas abordée ici. Note préliminaire : d'un point de vue de l'évolution, il est fondamental de garder à l'esprit que les organes constituant le système de production périphérique (poumons, trachée, langue, lèvres), ont tous une fonction première qui n'est pas liée à la production de la parole : respiration, déglutition, mastication, etc. |
|
Les poumons permettent en premier lieu d'alimenter les tissus du corps en oxygène par une alternance de cycles d'inspiration et d'expiration. La phonation se produit dans la très grande majorité des cas au cours de l'expiration. Le flux d'air expulsé des poumons se déplace jusqu'à arriver au niveau du larynx où plusieurs cas se présentent (cf. Comportement de la source laryngée durant la phonation). Le larynx est une structure composée de cartilages, de ligaments et de muscles, placés sous l'os hyoïde. Il est plus bas chez l'homme que chez la femme, ce qui résulte en une plus grande longueur du conduit vocal pour ces derniers. Les cordes vocales sont constituées de muscles et de ligaments recouverts d'une muqueuse. L'ensemble est attaché au cartilage thyroïde et aux cartilages arythénoïdes comme l'indiquent les figures suivantes.
Ces cartilages peuvent se déplacer latéralement et pivoter, entraînant ainsi une modification de la position et de la longueur des cordes vocales. On appelle glotte l'espace variable délimité par les cordes vocales et qui joue le rôle de valve entre la trachée et le conduit vocal. Les mouvements possibles permettent l'ensemble des positions intermédiaires allant de la fermeture totale de la glotte à son ouverture totale, comme le montrent les figures suivantes.
|
Lors de la phonation, l'air stocké dans les poumons est expulsé sous l'action de différents muscles de l'abdomen, créant ainsi un courant d'air qui parcourt la trachée jusqu'à la glotte, au niveau du larynx.
Tout comme le biseau d'une flûte peut vibrer dans certaines conditions, les cordes vocales peuvent elles aussi entrer en vibration. Pourquoi les cordes vocales vibrent-elles ? Cette question est au coeur du processus de phonation. Schématiquement, on peut dire que si la glotte est fermée et que l'on cherche à souffler, la pression subglottique (c'est-à-dire dans la trachée) augmente. Les cordes vocales ne sont pas complétement rigides et sous l'effet de la pression, elles s'écartent et laissent passer l'air, diminuant ainsi la pression sub-glottique. Ensuite, plusieurs phénomènes aérodynamiques (effet Bernoulli) et biomécaniques (myoélasticité) se conjuguent pour ramener les cordes vocales en position accolée, entraînant une hausse de la pression sub-glottique... et le cycle peut recommencer (cf. schéma ci-dessous). Le déplacement des cartilages aryténoïdes entraîne des modifications de la forme de la glotte et de la longueur des cordes vocales. Quel est l'effet d'un tel changement sur les vibrations créées au niveau de la glotte ? On peut prévoir grossièrement l'effet par analogie avec la corde d'une guitare ou d'un violon : plus on tend une corde de guitare, plus le son émis est aigü, et donc plus la fréuqence de vibration de la corde est élevée. A l'inverse, si on détend la corde, le son est plus grave (vibration de basse fréquence). Le phénomène est semblable avec les vibrations des cordes vocales, et la variation de tension appliquée (et donc leur allongement) influence la fréquence de vibration et donc la fréquence du son périodique généré. On peut également noter qu'une corde de guitare épaisse vibre à plus basse fréquence qu'une corde fine :le phénomène est le même chez l'être humain et il explique certaines différences en terme de fréquence fondamentale de la parole entre les hommes (qui ont des cordes plutôt épaisses) et les femmes (qui ont des cordes vocales plutôt minces). Dans ce paragraphe, nous nous sommes principalement concentrés sur les vibrations des cordes vocales ; nous allons cependant voir maintenant que tous les sons produits lors de la phonation ne mettent pas en oeuvre une telle vibration et que le répertoire d'utilisation de notre larynx est bien plus riche ! |
Si vous placez votre main au contact de la gorge au niveau de votre larynx (c'est-à-dire au niveau de la pomme d'Adam) et que vous parlez à voix haute, vous percevrez la vibration des cordes vocales.En y faisant un peu plus attention, vous constaterez que pour certains sons (comme le 's' de son, le 's' et le 'k' de ski,...) les cordes vocales ne vibrent pas.
Dans le premier cas, les vibrations des cordes vocales modulent le flux d'air issu des poumons. Cela résulte en une variation de la pression de l'air passant la glotte. Les oscillations des cordes vocales étant sinusoïdales, l'onde sonore produite au dessus de la glotte est également périodique sinusoïdale, en première approximation. Cette onde se propage alors dans le conduit vocal jusqu'aux lèvres. La figure suivante schématise le mouvement des cordes vocales au cours de la phonation d'un son voisé. La fréquence d'oscillation des cordes vocales est élevée : pour les hommes, elle se situe entre 100 Hz et 150 Hz
lors de la phonation normale (c'est à dire lors d'une conversation classique). Pour les femmes, elle est plus élevée (200 Hz à 300 Hz) et encore plus élevée pour les enfants (300-450 Hz).
Lorsqu'on produit des sons non voisés, les cordes vocales ne vibrent pas. Le son est alors produit par le frottement de l'air dans le conduit vocal entre la glotte et les lèvres. D'autres sons non voisés peuvent être produits, comme les sons 't' de tennis ou 'k' de kaki. De tels sons sont produits lorsqu'on écarte brutalement les cordes vocales après les avoir gardées en contact (fermeture totale de la glotte). Il s'agit alors de sons non voisés apériodiques impulsionnels. Enfin, si les cordes vocales vibrent mais que le flux d'air rencontre ensuite une constriction telle que le flux devient turbulent, le son produit résulte de la superposition d'un son périodique et d'un bruit apériodique (par exemple pour le son 'v' de vivant). L'étude des sons différents sons produits par l'appareil phonatoire humain fait l'objet du chapitre suivant. Ils ne seront donc pas détaillés plus précisément ici. Notons cependant que les deux mécanismes de production (vibration des cordes vocales et frottement du flux d'air dans le conduit vocal) ne sont pas antagonistes : il est en effet possible de superposer les deux effets (en faisant frotter dans des rétrécissements du conduit vocal l'air mis en vibration au niveau de la glotte). |
|
Le conduit vocal est le terme qui désigne la cavité remplie d'air qui s'étant de la glotte (larynx) aux lèvres. Cette cavité n'est pas rigide, et sa forme peut-être modifiée par le mouvement d'articulateurs (la langue par exemple). |
|
Il se compose du pharynx (décomposé en laryngo-pharynx,
oro-pharynx et naso-pharynx), de la cavité orale (ou buccale) de la cavité
labiale et de la cavité nasale qui constitue une alternative à
l'écoulement de l'air par la bouche. Sa longueur est en moyenne de 17,5 cm
chez l'homme. Notons que l'sophage débouche également au niveau du laryngo-pharynx, et que le rôle d'aiguillage entre les aliments ingérés (dirigés vers le tube digestif) et l'air inspiré (dirigé vers les poumons) est assuré par l'épiglotte. En cherchant à parler en mangeant, on a donc toutes les chances de s'étouffer à cause d'une erreur d'aiguillage...
|
|
Tout comme le musicien modifie la forme de la cavité de son instrument pour moduler les sons produits, l'homme modifie la forme de son conduit vocal pour produire les sons de son langage. La phonation met en jeu un grand nombre de muscles qui exercent un contrôle précis sur différents articulateurs. Les mouvements de la langue mettent en jeu pas moins de 17 muscles ! Les principaux articulateurs sont la langue, le vélum, les dents, les lèvres et la mandibule (mâchoire inférieure). Leur rôle principal est de modifier la forme du conduit vocal. En effet, comme nous allons maintenant le voir, le son produit est intimement lié à cette forme, en particulier à l'existence ou à l'absence de rétrécissement du conduit et s'il existe, à sa position dans le conduit. |
|
Le chapitre suivant est consacré à la relation existant
entre le mouvement et la position des articulateurs d'une part, et les
sons produits d'autre part. Avant d'aborder ces aspects techniques sur un
plan théorique, nous vous proposons quelques experiences simples pour
éveiller votre perception du "geste" de production :
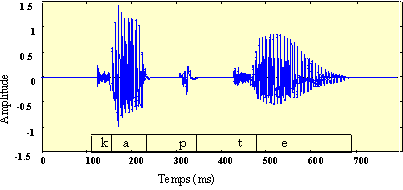 Son Son
|